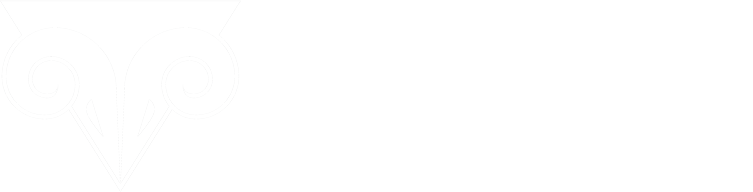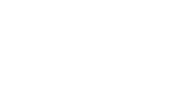Fuck America
Publié le
Fuck America est un roman qui fait plaisir. Le plaisir d’une double découverte : celle d’Edgar Hilsenrath, écrivain allemand d’origine juive injustement méconnu en France ; et celle d’un personnage / narrateur nommé Jakob Bronsky. Inutile de faire durer le suspense : il s’agit en fait d’une seule et même personne. Car Fuck America est un récit largement autobiographique. C’est bien ce qui fait la force de ce petit bijou littéraire. La vie, la vraie, dans toute sa crudité, y pulse à chaque page. C’est drôle, tonique et réjouissant. Ce qui n’empêche ni la gravité ni la réflexion. Fuck America est donc une excellente surprise.
Mais il est temps de faire connaissance avec Jakob Bronsky : en 1952, il débarque aux Etats-Unis. C’est un survivant, traumatisé par son expérience du ghetto pendant la guerre. Un immigré juif qui a échappé à la folie nazie. Il s’installe à Broadway, et devient très vite l’un des clients réguliers d’une cafétéria où se réunit la communauté juive. Exilé volontaire dans « un pays qu’il ne comprend pas et qui ne le comprend pas », il enchaîne les jobs mal payés — serveur, portier de nuit, promeneur de chien — et loge dans des hôtels crasseux. Autant dire que l’Amérique, loin d’être une terre promise, se transforme pour lui en une véritable jungle. Et ici aussi, en plein cœur des Etats-Unis, il va devoir apprendre à survivre. Mais Jakob Bronsky a une ambition : devenir écrivain. Chaque nuit, il s’acharne à écrire son roman, un récit inspiré de sa propre vie et pour lequel il a trouvé un titre imparable : Le Branleur…
Fuck América est un roman dont tout le charme tient dans son personnage principal. Anti-héros radical, loser magnifique, Jakob Bronsky est un type formidable auquel on s’attache très vite. On a envie qu’il s’en sorte. Et on le suit, jour après jour, nuit après nuit, dans sa quête héroïque, dans sa lutte acharnée pour échapper à sa condition d’immigré. Et c’est là où Hilsenrath est vraiment malin : sans en avoir l’air, par petites touches, il nous parle de l’exil, de la pauvreté, de la solitude, du destin et de la fatalité. Mais toujours avec humour. L’écriture rythmée, d’une incroyable spontanéité — assez proche du langage parlé —, donne à ce roman une tonalité très particulière. S’y ajoute un humour grinçant, féroce, absurde et parfois macabre. Une forte propension aussi à parler de sexe d’une manière très crue. On n’est pas très loin de certains romans de Charles Bukowski (Women, Les Contes de la folie ordinaire…) ou de John Fante ( Demande à la poussière, Mon chien stupide…). Hilsenrath n’a peur de rien, il ose même s’attaquer à un tabou absolu : parler de la Shoah avec une ironie distanciée. C’est d’ailleurs une chose qui lui a été beaucoup reprochée, et qui explique pour une bonne part les difficultés qu’il a pu rencontrer, à ses débuts, pour trouver un éditeur (lire à se sujet la postface, courte mais éclairante.).
Roman acide, hilarant et jubilatoire, Fuck América est une friandise littéraire à ne pas rater. D’autant plus que l’éditeur a particulièrement bien soigné la présentation : couverture, mise en page, postface… C’est du très beau boulot, et qui ajoute encore au plaisir de la lecture. L’aventure ne s’arrête d’ailleurs pas là, puisque les éditions Attila ont déjà prévu d’éditer deux autres romans d’Hilsenrath : Le Nazi et le barbier et Nuit.